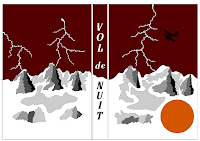L'origine de ce travail tient à un besoin exprimé par une
collègue d'atelier. Celle-ci possédait un petit livre auquel elle tenait
beaucoup en tant que souvenir familial.
Son format de seulement 92x142x13 (en mm) interdit de la placer dans une bibliothèque où il disparaitrait entre les autres volumes. D'où l'idée de le contenir dans une boite en forme de livre, qui lui donnera une présence suffisante dans les rayonnages.
Il existe des modèles de
boite-livre dans la littérature, mais qui nous ont paru d'une
construction trop lourde pour un ouvrage aussi léger. Je me suis donc
proposé de réaliser un modèle personnel, réunissant les conditions
suivantes:
L'habillage pourra être de cuir ou de toile, l'intérieur étant garni d'un papier velouté.
Le livre disposé à l'intérieur aura une tolérance de position de 5mm sur tout le pourtour, et de 3mm en épaisseur.
Le modèle qui est développée ci-dessous a été réalisée dans un carton mince d'épaisseur 2mm (en fait un carton de calendrier commercial). Ce choix est intéressant pour un livre de cette taille qui justifie d'une boite assez légère.
Les plans ci-dessous sont côtés pour le livre avec les dimensions 92x142x13. On pourra facilement adapter ces dimensions à un livre quelconque à partir des schémas ci-dessous.
Ci-dessus, la boite est représentée en développée vue de dessus. On trouve en quelque sorte deux boites incomplètes ( en bleu et gris) qui, après repliement, viennent s'emboiter l'une dans l'autre. Elles sont posées sur les deux plaques (en vert), elles mêmes complètement collées sur une cartonnette de 3/10, que l'on aperçoit en orange entre les deux plaques.
L'épaisseur globale de la boite sera égale à la hauteur des traverses (ici: 18mm) augmentée des 2 épaisseurs de carton (soit ici 2x2mm, soit au total 22mm)
Note importante: Pour une bonne courbure du dos,: la zone courbée (orange) qui formera le dos sera égale à 1,5 fois cette hauteur totale (soit ici 33mm). On peut moduler légèrement cette distance suivant que l'on souhaite un dos plus ou moins arrondi.
La coupe ci-dessus suppose que la boite de droite a été rabattue sur celle de gauche. Les deux boites viennent s'emboiter, la partie centrale de cartonnette se courbe et forme l'arrondi du dos (orange).
Les schémas suivants donnent les étapes de la construction.
Ci-contre les deux plats en carton, que l'on nommera "base" (bleu fonçé) et "couvercle"(bleu clair), ont été préparés ainsi que la cartonnette qui les supporte entièrement, dont on aperçoit la partie centrale "dos" (orange), conformément au plan I. Cependant la cartonnette est coupée légèrement plus grande (2 à 4mm) que l'ensemble de façon à déborder sur les bords des cartons. Pour l'instant, seule la "base" est collée sur la cartonnette mais non le couvercle.
Ci-contre à droite le "couvercle" a été collé sur la cartonnette sauf sur une bande de 10mm (bleu clair) que l'on appellera "planchette". Il suffit pour cela d'encoller la zone de contact sur la cartonnette puis protéger la zone "planchette" par une bande de papier avant d'appliquer le plat.
Préparer un V dans une bande de carton de la hauteur des cloisons (ici 18mm), dont les ailes sont de longueur env. 2/3 de la largeur des plats (ici env. 80mm). Les bouts du V (en B) seront rapés sur un abrasif de façon à leur donner un angle d'env. 45° vers l'intérieur.
 De même, préparer la traverse (plan I), en n'oubliant
pas de l'échancrer aux deux bouts haut et bas sur 12mm x 2mm.
De même, préparer la traverse (plan I), en n'oubliant
pas de l'échancrer aux deux bouts haut et bas sur 12mm x 2mm.
La "planchette" non collée se détache ainsi que la partie restante du couvercle, comme
l'illustre le schéma ci-contre.
Le schéma ci-dessus indique que la cartonnette a été arasée sur tout les bords au ras des cartons.
Sur le schéma ci-contre, on voit que l'on a collé la planchette sur le traverse et sur le V, centrée.
Le schéma ci-dessus montre la bande de cartonnette "dos" (v. plan I) venant s'enrouler et se coller exactement de façon à couvrir la planchette.
On peut alors placer le "couvercle" en le collant sur le V, jointif (mais non collé) à la planchette. On veillera dans cette opération à assurer l'équerrage de l'ensemble sur 3 côtés, quitte à jouer très légèrement sur la fente AA entre ces deux pièces (qui sera la charnière du couvercle).
On pose alors sur l'ensemble le matériau de couverture (en vert), débordant d'au moins 15mm.
Ci-dessus, la couverture a été recoupée suffisamment au niveau des coiffes pour pouvoir rentrer dans les échancrures de la traverse, puis rempliée sur tout le pourtour, les coins étant finalisés comme en reliure.
Sur le schéma ci-contre l'ensemble précédent apparait renversé. On a disposé un bloc formé de
quelques cartons superposés (au moins 8mm d'épaisseur au total) dont les
dimensions sont exactement l'intérieur du "couvercle" (plan I). On
colle ce bloc par l'intermédiaire d'une feuille de papier collée sur le
plat en 4 points, et au dos du bloc, de façon à pouvoir l'arracher ultérieurement sans trop de dégâts.
On prépare les flancs de la boite couvercle aux dimensions du plan I. Il est préférable de les reprofiler d'un arrondi partiel, comme sur le schéma.
Sur le schéma de gauche, on a collé ces flancs au dos du couvercle, en les serrant (sans les y coller) contre le bloc. Puis on a complété la boite par la cloison BB qui les rejoint. Pour un meilleur réglage des angles, il est préférable d'araser les cartons à 45° intérieur (sur un abrasif) à leurs jonctions en B. On peut mieux assurer la forme des coins en collant un kraft (non représenté sur la figure) à cheval sur les angles. Les carrés jaunes représentés sont de petites cales en cartonnette de 6/10 pour réserver un espace avec la boite extérieure.
Ayant "arraché" le bloc de calage, on referme la boite en collant à nouveau, mais légèrement le couvercle sur le V. On prépare maintenant les flancs de la boite extérieure "base", en les coupant volontairement trop longs. Les arrondis au fond sont ajustés par des essais sans collage. Il est conseillé à ce stade d'habiller de son papier définitif l'extrémité arrondie arrondie (ici en rouge), jusqu'à la charnière, car il sera difficile de le faire après.
Ci-contre on a recoupé ces flancs suivant le plan I et on
les a collés sur la base en les appuyant sur la boite "base" .Puis on a
collé le 3ème côté de la boite "couvercle", avec les mêmes précautions
aux angles que pour la boite intérieure.
On rouvre la boite en décollant le couvercle du V, et l'on arrache le V de la base. On peut alors habiller tous les flancs d'un papier choisi.
Afin de renforcer la charnière du couvercle, qui pour l'instant n'est assurée que par la couvrure, on colle au fond, à cheval sur le plat et la bande de 10mm. une bande de mousseline (ici en marron), que l'on poussera dans l'espace intérieur de la charnière, couvercle ouvert à env 60°. .Laisser sécher dans cette position.
Enfin on pourra habiller l'intérieur d'un papier velours, en 2 étapes. D'abord le fond en incluant la traverse; ensuite le couvercle intérieure 'en recouvrant partiellement le revers de la planchette, la boite étant ouverte à 60° environ.
Les photos ci-dessous montrent le
modèle qui a été réalisé (à gauche), puis à droite le coffret contenant
le livre auquel il est destiné
 |
.jpg) |
Note: le modèle ci-dessus ne convient pas si l'on souhaite former un dos avec nerfs, car le dos n'a pas la robustesse pour supporter la pression de la pince à nerfs. Cet objectif conduirait à une procédure notablement différente.
.JPG)
.JPG)












.png)